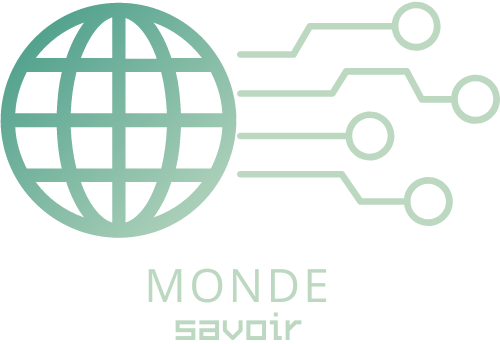Face aux enjeux environnementaux actuels, le cadre des marchés publics se transforme pour intégrer davantage de critères écologiques. Cette évolution présente à la fois des obligations et des opportunités pour les entreprises souhaitant répondre aux appels d’offres publics. Les Echos Le Parisien Services (LELPS), qui propose notamment un service dédié aux marchés publics parmi ses 14 solutions, vous aide à comprendre ces nouveaux enjeux.
L’intégration des exigences environnementales dans les appels d’offres
Le développement durable s’impose progressivement dans les marchés publics français depuis 2004, avec une accélération notable ces dernières années. En effet, la part des critères environnementaux est passée de seulement 3% en 2009 à 19% en 2019, témoignant d’une prise de conscience croissante. Cette tendance s’inscrit dans une dynamique plus large où les echos le parisien services (LELPS) observe que les entreprises doivent désormais se préparer à des exigences encore plus strictes dans un avenir proche.
Les clauses vertes obligatoires selon la loi
La législation française a considérablement renforcé l’intégration des préoccupations environnementales dans la commande publique. La loi Climat et Résilience constitue une avancée majeure en rendant obligatoire l’inclusion d’au moins un critère environnemental dans chaque marché public, sauf justification particulière. Ce dispositif s’inscrit dans un cadre législatif plus large comprenant également la loi sur l’industrie verte et le Code de la commande publique de 2019, dont les articles L.2111-1 et L.2112-2 précisent la nécessité de prendre en compte la performance environnementale.
Ces obligations concernent plusieurs aspects environnementaux comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation de matériaux recyclés, la performance énergétique et la gestion durable des ressources. Il est crucial de noter que le non-respect de ces obligations peut entraîner des contestations devant le juge administratif et des pénalités contractuelles, d’où l’importance de bien maîtriser ces nouvelles exigences.
Les bonnes pratiques pour valoriser sa démarche écologique
Pour se conformer efficacement aux nouvelles exigences environnementales, les entreprises doivent adopter une approche structurée. La première étape consiste à bien comprendre les critères verts qui peuvent englober la consommation d’énergie, les émissions de CO₂, la durabilité des matériaux, la gestion des déchets, la réduction des emballages, l’impact sur la biodiversité et l’utilisation de processus de production durables.
Une bonne pratique consiste à intégrer ces préoccupations dès la conception des offres, en détaillant précisément comment l’entreprise répond aux exigences environnementales spécifiées dans le cahier des charges. Les acheteurs publics recherchent des indicateurs mesurables et objectifs, il est donc recommandé de présenter des données quantifiables plutôt que des déclarations générales. Les entreprises ayant déjà mis en place une démarche RSE structurée disposent d’un avantage certain pour répondre à ces nouveaux enjeux.

Comment se démarquer grâce à une approche durable
Dans un contexte où les critères techniques et le prix restent prépondérants (respectivement présents dans 82,4% et 73,4% des appels d’offres), l’aspect environnemental peut devenir un élément différenciateur majeur. Bien que la qualité de l’offre demeure un facteur important, les entreprises capables de démontrer leur engagement écologique peuvent se distinguer favorablement de leurs concurrents.
Les certifications et labels à mettre en avant
Les labels environnementaux constituent un atout précieux pour valoriser une démarche écologique dans les marchés publics. L’ADEME a analysé près de 100 labels environnementaux qu’elle classe en deux catégories : « Excellent choix » et « Très bon choix », en fonction de leur fiabilité structurelle et environnementale. Cette classification couvre 14 catégories de produits de consommation courante, offrant ainsi un large éventail de possibilités pour les entreprises de tous secteurs.
Parmi ces labels, l’Écolabel européen, créé en 1992, occupe une place particulière car il est le seul label écologique officiel reconnu dans l’Union européenne et conforme aux exigences du code de la commande publique. Il est important de noter qu’un acheteur public peut exiger un label spécifique si ses caractéristiques sont liées à l’objet du marché, mais doit accepter les labels équivalents, ce qui laisse une certaine flexibilité aux entreprises.
L’analyse du cycle de vie comme atout concurrentiel
L’analyse du cycle de vie des produits et services constitue un argument de poids dans les réponses aux appels d’offres. Cette approche globale permet d’évaluer les impacts environnementaux à chaque étape du cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie du produit, en passant par sa fabrication, sa distribution et son utilisation.
En intégrant cette dimension dans leurs propositions, les entreprises démontrent leur capacité à penser au-delà du simple produit ou service pour considérer l’ensemble de ses implications environnementales. Cette vision holistique répond parfaitement aux attentes des acheteurs publics qui cherchent à évaluer l’impact global de leurs achats sur l’environnement. Des aspects comme la durabilité, la réparabilité, l’utilisation de technologies propres ou la limitation des déchets deviennent ainsi des arguments commerciaux de premier plan.